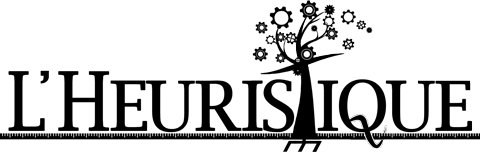Ressac du temps
23 décembre, le matin. 8 h 32. Le temps presse. Mes valises ne sont pas prêtes et je dois être à la gare pour 9 h. Je cours dans la salle de bain, attrape ma brosse à dent, mon étui à lunettes, cours vers le salon, attrape les deux livres qui traînent sur la table basse, la couverture sur le divan et retourne dans ma chambre où je lance tous ces objets dans ma valise. Des yeux, je survole la chambre pour être certaine de ne rien oublier et je tombe sur le réveil. 8 h 38. Vite! Vite! Je continue mon tour de la chambre. Les pantoufles! Le plancher est toujours froid dans la chambre d’invité chez ma mère. Hop! Dans la valise. J’ai l’impression de courir comme une poule sans tête, bien que je n’en aie jamais vue. Je referme la valise, en souhaitant de tout mon être de n’avoir rien oublié. Évidemment, comme je suis pressée, elle décide de ne pas se fermer. Je sais que j’ai beaucoup de vêtements, mais avec la température cette année, je ne sais plus quoi apporter. Hier, il a fait 18 degrés Celsius et aujourd’hui, seulement 7. Je n’ai toujours pas vu une seule petite trace de neige au sol. Mais j’ignore la température qu’il fera demain au Bas-Saint-Laurent. J’ai donc des jupes courtes, des jupes longues, des pantalons longs, des jeans, des collants, des chandails légers, des tricots, des foulards, des souliers et des bottes. Et j’ai peut-être choisi une valise trop petite…
8 h 43. Trop tard. Je n’ai pas le temps de tout transférer. J’appuie sur ma valise. Elle ne ferme pas. J’y dépose un genou. Elle ne ferme pas. Je dépose mon deuxième genou. Elle ne ferme pas. Et puis tant pis. Je m’assois de tout mon poids, attrape le fermoir de la fermeture éclair et enfin, j’arrive à le faire glisser, doucement et non sans résistance, jusqu’au bout. J’enclenche le verrou et pousse un grand soupir. Elle est fermée.
8 h 48. Une chance que la gare n’est qu’à quelques pas de ma maison. Je tire ma valise jusqu’à la porte d’entrée. J’enfile une paire de souliers quelconque, aucune importance, il n’y a pas encore de neige, mon manteau et un foulard que je dépose seulement sur mes épaules. Je me dépêche à sortir et à verrouiller la porte. Je cours jusqu’à la gare. Le train y est déjà.
Je pousse la porte et une horloge me fait face, indiquant 8 h 52. Je tourne la tête vers le comptoir. Aucune file. À bout de souffle, je m’élance vers la mademoiselle qui mâche sa gomme et compte les tuiles du plafond. Je lui demande un billet. Elle s’exécute.
Sans presse. Une touche après l’autre.
Je commence à piétiner.
Dou-ce-ment.
En mâchant sa gomme rose qu’elle fait sans cesse éclater. Et qui agresse mes oreilles.
Je jette de plus en plus de regards vers l’horloge qui semble de plus en plus grosse.
Len-te-ment.
8 h 56.
Alors que mes ongles commencent à jouer du piano sur le comptoir, elle me tend, enfin, mon billet. Elle débute un laïus pour expliquer quand le donner, où le donner, à qui le donner,… Mais elle n’a pas terminé que je suis déjà sur le quai à tendre mon bagage à l’employé. Dès qu’il l’empoigne, je m’engouffre dans le wagon et m’installe dans mon fauteuil. J’y suis. À temps. Je ne peux m’empêcher de sourire et de pousser un long soupir de soulagement.
À côté de moi, une dame d’un certain âge me regarde.
- Quand tes jambes ne te permettront plus de courir, tu apprendras à être à l’heure.
Les yeux ronds, je la fixe. Elle ne connaît pas mon histoire. Pour qui se prend-elle pour me donner des leçons? Je détourne la tête, comme si je n’avais rien entendu.
Doucement, le train se met en route. Au fil du trajet, je vois les villes s’estomper, les forêts défiler et le soleil disparaître. Dans le wagon, une adolescente de quatorze ans, écouteurs sur les oreilles, somnole, la tête appuyée sur la vitre. Ma vieille voisine a décidé de changer de place et de l’autre côté du passage, elle semble plonger dans la lecture du roman qui date de la guerre… Et moi, je les observe. Nous ne sommes que trois dans ce wagon, un 23 décembre, nous devons avoir un point commun, mais je cherche encore lequel. Puis, en regardant de nouveau vers l’extérieur, je vois de légers flocons tomber et se déposer sur la boue et les sapins qui se font de moins en moins nombreux.
Le train effectue un virage et au détour de la montagne, je l’aperçois… Il est toujours aussi grand, aussi beau et aussi majestueux. Celui qui m’a accompagné durant des années est enfin là, devant mes yeux. Il chahute un peu, entraîné par le vent et la neige qui ne cesse de s’accumuler, même sur les rails. Ces derniers temps j’en rêvais, il me manquait. Et le voilà, qui n’a pas changé. Il m’attendait. La vieille dame me tire de mes rêveries en s’adressant à lui :
- Ce que j’espérais te voir!
Je vois cette femme, qui me semblait si antipathique, s’adresser au fleuve, les yeux remplis de larmes. Derrière elle, l’adolescente a retiré ses écouteurs et plonge, elle aussi, son regard dans le fleuve.
Le train ralentit et s’immobilise. Pendant de longues minutes, nous restons silencieuses à observer le fleuve, chacune perdue dans nos pensées. La neige s’épaissit et bientôt, le sol disparaît, tout comme les rails. Les quelques arbres sont ensevelis sous la neige, le fleuve s’agite. Les vagues se gonflent et des moutons d’écume viennent se fondre dans la neige accumulée sur la rive.
Sans avertir, un employé fait bruyamment glisser la porte de notre wagon et sans se soucier de nos rêveries, il nous avertit que le train est immobilisé en raison de la neige et de la glace. Nous pourrions être coincés un certain temps… Et je n’écoute pas le reste de son discours. J’entends vaguement que quelqu’un ou quelque chose est en route pour nous sortir de notre prison. Mais toutes trois, nous ignorons cet homme qui ne cesse de parler et nous regardons le fleuve.
Je m’approche de la vieille femme et lui demande pourquoi elle souhaitait tant voir le fleuve. Et elle me raconte qu’il y a très longtemps, alors qu’elle n’était qu’une adolescente, elle était partie de chez elle. Intéressée, l’adolescente du wagon se rapproche et se joint à moi pour écouter la suite. La vieille femme se plonge dans ses souvenirs et nous la suivons dans un dédale de forêts et de villes où le fleuve l’accompagne en pensées à chaque voyage. Elle nous raconte l’histoire d’une adolescente esseulée et je vois dans les yeux de ma voisine de siège qu’elle sent qu’elle parle d’elle. Puis, elle nous raconte l’histoire d’une jeune femme qui n’a jamais le temps et au fond de moi, je la comprends. Elle raconte l’histoire d’une fillette amoureuse du fleuve en nous désignant ce large cours d’eau qui nous fait face. Et j’ai l’impression que le temps est suspendu aux mains de cette vieille dame qui, en nous contant ses histoires, manipule le temps vers l’avant ou vers l’arrière. Je croise le regard de l’adolescente et je suis certaine que nous songeons à la même chose : en cette vieille dame, nous voyons ce que nous pourrions devenir, ce que nous sommes et ce que nous étions. On est comme enfermés dans un sablier où tourbillonne la neige douce[1]. Et lorsque la femme termine son histoire, le train se remet en branle et d’un vague geste de la main, elle semble redonner au temps la permission de s’égrener lentement, comme avant…
Peu de temps après, le train s’immobilise à la gare et nous sommes toutes trois rendues à destination. En silence et la tête pleine des histoires de la vieille femme, je prends ma valise et descends sur le quai enfoui sous la neige. Les employés de la gare, afférés à déneiger, la tuque sur les yeux, ne nous voient pas. Mais avant de poursuivre nos chemins respectifs, nous nous embrassons, regardons le fleuve ensemble, une dernière fois. Et nous nous séparons. L’adolescente quitte vers la droite et moi, vers la gauche. Derrière moi, j’entends un léger « Bonne chance! » lancé par une petite voix rauque. J’ignore à qui il est adressé, je me retourne et croise le regard de l’adolescente. Nous regardons vers l’endroit où se trouvait la vieille dame, mais elle n’y est plus. Partout autour, il n’y a aucune trace d’elle. Ne sachant trop ce qu’elle est devenue, j’envoie un dernier signe de la main à la jeune adolescente qui me le rend d’un charmant sourire. Je ne la reverrai sans doute jamais, mais il est certain que cette fois, je resterai près de mon fleuve…
[1] HÉBERT, Anne. Kamouraska, Coll. « Points », Paris, Éditions du Seuil, 2006, 246 p. (pour cette phrase : p. 221)