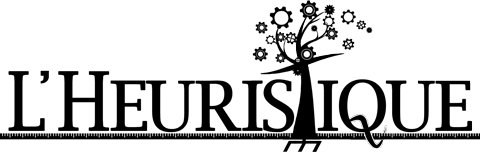Projet de fin de maîtrise… en Haïti!

Photo prise par Marie Lhuilier, 2018
Le 12 septembre 2018, je m’envolais pour Haïti pour mon projet de fin de maîtrise, bien loin de m’imaginer toutes les péripéties, toutes les rencontres que j’allais faire. Ce que je connaissais d’Haïti? Que c'était le pays le plus pauvre du continent américain, mais aussi que ce pays avait eu son heure de gloire par le passé en étant déclaré Première République noire en 1804 au grand dam de Napoléon Ier et couramment mentionné comme la perle des Antilles!
Pourquoi Haïti?
Une opportunité au trait d’aventure! J’ai été séduite par le projet du professeur Frédéric Monette (génie de l’environnement) : créer un Centre de recherche et de référence en eau et assainissement (CR²EA) sur le sol haïtien. Contrairement à beaucoup de projets de développement mis en place en Haïti, celui-ci avait la particularité d’impliquer directement le milieu universitaire haïtien dans la recherche de solutions liées à l’absence d’assainissement de certaines localités d’Haïti. Mon rôle était de collecter le plus d’informations sur les projets d’assainissement développés jusqu’alors afin d’en dégager des axes de recherches visant à alimenter le futur centre.
Pourquoi l’assainissement?
Ce qui a motivé ce projet est en premier lieu l’absence d’une couverture complète en assainissement en Haïti. Selon les données de la Banque mondiale, 19 % de la population haïtienne pratique encore la défécation à l’air libre. La mortalité infantile, souvent causée par les maladies liées à l’eau, est de 59 ‰. En comparaison, le taux de mortalité infantile en France est de 3,7 ‰ et au Canada de 4,9 ‰. L’assainissement présente donc des enjeux sanitaires, mais également économiques et environnementaux. En effet, selon une étude du Programme des Nations Unies pour le développement, menée en 2016, il apparaît que 1 $ investi dans l’assainissement en rapporte 8 $, par l’amélioration de la productivité, la baisse des dépenses liées à la santé, etc. Par ailleurs, l’absence d’assainissement conduit à des rejets sauvages dans le milieu naturel des eaux usées et des boues sans traitement préalable pouvant conduire à une contamination de ce milieu et des nappes phréatiques. Enfin, l’assainissement touche également à la dignité humaine : la défécation à l’air libre est déshonorante et ne permet pas une sécurité physique des personnes.
L’assainissement en Haïti
L’assainissement en Haïti fait intervenir de nombreux acteurs : des partenaires de développement [organisations non gouvernementales (ONG) et bailleurs de fonds], des institutions publiques (ministères, mairies, etc.), des firmes privées et des professionnels à leur propre compte souvent informels. L’assainissement est majoritairement réalisé de manière autonome, c’est-à-dire que chaque ménage doit prendre en charge la construction d’une latrine et d’une fosse. Une fois que celle-ci est remplie, soit le ménage la fait vider, soit il la condamne et en creuse une autre. Quelle que soit la solution choisie, le contenu de la fosse sera rejeté dans la majorité des cas dans le milieu naturel. Dans le cas où le ménage déciderait de faire vider la fosse, il peut faire appel à une entreprise de vidange ou à un bayakou (mot créole pour vidangeur).
La profession de bayakou
Cette profession existe en Haïti, mais également dans d’autres pays. Le bayakou est un vidangeur manuel assurant un service essentiel à l’assainissement des villes. En raison de sa proximité avec les matières fécales, cette profession est entourée d’un certain mysticisme dans la culture vaudou. Le bayakou est d’ailleurs marginalisé et discriminé. Il doit opérer en secret la nuit, parfois dans une autre ville pour éviter d’être reconnu et de porter préjudice à la réputation de l’ensemble de sa famille, souvent ignorante de sa véritable activité. Ne bénéficiant d’aucune reconnaissance légale, il risque une amende, voire une nuit d’emprisonnement, s’il est surpris par les policiers. Pourquoi cette profession est-elle si peu valorisée? Le bayakou descend nu dans la fosse qu’il vide de ses propres mains à l’aide d’un bol ou d’une pelle. Il s’expose ainsi à de nombreux risques sanitaires. Le contenu des fosses comprend souvent de la vaisselle brisée et des seringues, ce qui augmentent alors les risques de blessures et, conséquemment, les risques de contamination de ces travailleurs. Faute de soutien municipal, les matières collectées sont rejetées directement dans le milieu naturel.
La place des ONG
Les ONG ont une place prépondérante en Haïti et tout particulièrement dans le secteur de l’assainissement. Même si elles partent d’une bonne intention, leurs actions n’ont souvent pas l’effet espéré. Par exemple, les ONG avaient tendance par le passé à financer des infrastructures d’assainissement pour des ménages en situation précaire. Cela a eu pour conséquence de créer un attentisme de la population, négligeant l’entretien et la maintenance, et par la suite un refus de payer pour quelconque service d’assainissement.
Depuis plus de 40 ans que les ONG agissent dans ce domaine en Haïti, les problématiques sont loin d’être résolues et il a même été montré que la situation s’est détériorée. Pourtant, les sommes investies sont significatives et elles se chiffrent en plusieurs millions, voire en milliards de dollars depuis l’arrivée des ONG. C’est à se demander si les sommes engagées depuis n’auraient pas permis de doter Haïti d’un système d’assainissement collectif complet.
Les freins à la mise en place d’une couverture efficace en assainissement
Les principaux freins à la mise en place d’une couverture en assainissement sont :
• la multiplicité des acteurs qui rend difficile leur coordination;
• la faible capacité d’investissement du pays;
• le manque de priorisation du secteur par le gouvernement;
• la non-application des normes et lois;
• le manque de lieu de dépôt ou de traitement;
• le caractère tabou de l’assainissement.
Épilogue
L’assainissement a beau sembler être dans une impasse, il faut noter une certaine évolution du secteur. La création d’une Direction de l’assainissement au niveau national en 2009 a permis d’améliorer la coordination des acteurs. Des actions ont été entreprises pour susciter une implication des maires dans le but de mettre fin à la défécation à l’air libre. Les partenaires de développement se dirigent vers des actions de sensibilisation et de formation pour atténuer la relation de dépendance créée avec les ménages. De nombreuses études sont actuellement menées dans le pays pour mettre en place des solutions durables, accessibles et adaptées au contexte local.
Ce projet aura permis de consolider le partenariat entre l’ÉTS et deux universités haïtiennes (Université d’Etat d’Haïti et Université Quisqueya) et à des étudiants des deux pays de collaborer, démontrant une solidarité Nord-Sud. De plus, ce projet permet de sensibiliser la communauté de l’ÉTS aux problématiques liées à l’assainissement rencontrées en Haïti et peut encourager des étudiants à s’impliquer dans de tels projets. La réalisation du projet a eu des retombées importantes sur la communauté haïtienne, puisqu’il a permis d’impliquer le milieu universitaire dans le secteur de l’assainissement et de réaliser une capitalisation des données qui seront essentielles pour les projets futurs.
Remerciements aux contributeurs
Nous tenons à remercier l’ensemble de nos contributeurs pour leur soutien matériel et financier: l’École de technologie supérieure, l’Université Quisqueya, l’Université d’Etat d’Haïti, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), le Bureau du recrutement étudiant et de la coordination internationale (BRECI), le Fonds de développement durable de l’Association étudiante de l’ÉTS (FDDAÉÉTS) et le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (France). Nous tenons également à remercier nos proches pour leur soutien durant la préparation et la réalisation du projet.