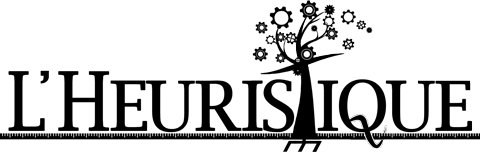Les systèmes adaptatifs complexes, la clé du Développement durable?
La linéarité de nos sociétés, une problématique
Les systèmes humains sont conçus selon une conception linéaire du monde. Il s’agit essentiellement de relier les différents points sociaux, économiques ou environnementaux les uns aux autres pour faire fonctionner le système. Ainsi, dans la conception moderne, nous nous dirigeons vers une fin, la croissance, sans que nous changions quoi que ce soit à nos conceptions des finalités vers lesquelles nous nous dirigeons. L’extraction de la matière première de la nature pour ensuite la transformer et la rendre, sous forme transformée, à la nature. Ce que l’on appelle les déchets en est un très bon exemple. Cela nous mène maintenant vers un gouffre environnemental, car pour soutenir les activités humaines, il nous faut désormais plus d’une Terre par année. Nous vivons actuellement sous un crédit environnemental et la dette ne fait qu’augmenter. Cette linéarité repose essentiellement sur une conception de l’homme dominant la nature. Cela est faux, comme le typhon Haiyan aux Philippines nous l’a sauvagement rappelé. L’homme reste soumis au cadre naturel, comme la nature est soumise à l’homme, malgré les percées technologiques. Il faut donc changer le fonctionnement global des activités humaines pour nous permettre de prospérer dans une optique soutenable. Les technologies ne pourront nous sauver à elles seules d’un épuisement du capital naturel. Elles seront des outils qui nous permettront d’être plus durables, mais pas de l’être à proprement dit. Donc, comment faire pour devenir durable et ainsi soutenir l’existence humaine à travers les âges?
Ce que l’étude des écosystèmes nous apprend
La durabilité dans le temps des écosystèmes naturels serait une propriété émergente selon certains chercheurs et chercheuses. L’émergence d’une telle propriété est possible grâce aux interactions internes des écosystèmes. Il s’agirait d’un système dynamique qui doit continuellement s’adapter à un environnement en constante évolution. La manière dont les écosystèmes réussissent à devenir durables dans le temps reste un mystère que nous ne parvenons pas à résoudre à l’aide d’un modèle de pensée orthodoxe. L’homme se doit de comprendre le fonctionnement des écosystèmes pour être en mesure de faire émerger la durabilité dans son système socio-économique. La théorie de systèmes adaptatifs complexes permet d’établir les bases d’une compréhension de ces interactions qui nous entourent. Cela nous donne les outils pour entreprendre les actions nécessaires et ainsi accomplir les changements structurels qui sont nécessaires pour en arriver à une société durable.
Les systèmes adaptatifs complexes
La grande différence entre un système complexe par rapport à un système linéaire est sa prédictibilité. Ainsi, dans un modèle linéaire, tel que les équations chimiques, on est en mesure de prédire son résultat. Or, dans un modèle complexe, il est pratiquement impossible de prévoir les résultats futurs si l’on ne modélise pas toutes les relations du système. Comme toutes les parties sont interdépendantes, il n’est pas possible de décrire la réponse du système à un changement. Comment bien comprendre le fonctionnement et les dynamiques de ces systèmes si modéliser l’intégrité du système est pratiquement impossible? Il faut alors analyser la manière dont ces systèmes évoluent et s’adaptent à leur environnement. Lorsqu’ils évoluent et qu’ils ont la capacité d’apprendre et d’acquérir de l’expérience, il s’agit alors de systèmes adaptatifs complexes. L’élément si spécial de ce type de système est sa capacité de s’adapter aux relations non linéaires qui la composent. Ils permettent ainsi d’avoir des éléments surprenants tels que les propriétés émergentes, l’auto-organisation et la coévolution. Comme tout système dynamique, ils ont des boucles de réponses à la fois positives et négatives. Ce sont ces boucles qui vont faire en sorte qu’un simple battement d’ailes peut déclencher un ouragan ailleurs dans le monde, comme l’effet papillon nous le démontre. Les systèmes naturels et humains font tous les deux partie de cette classe de systèmes complexes. Les villes, moteurs du développement économique, ou les forêts primaires, riches en biodiversité, forment les noyaux de la structure organisationnelle de ces systèmes, les attracteurs. L’archéologie par exemple, nous permet de retracer l’évolution des systèmes dynamiques humains et naturels. Que ce soit l’effondrement des civilisations antérieures ou les grandes extinctions, elles nous permettent de mieux comprendre comment on passe d’un attracteur à un autre. En effet, elles nous permettent de comprendre les phénomènes de transition d’un attracteur à l’autre, par exemple, la transition d’une civilisation à une autre. Généralement, ces transitions sont passablement instables et ont beaucoup de turbulences, car elles n’ont pas été prévues. Il se pourrait bien, d’ailleurs, que nous ayons de la difficulté à faire la transition énergétique en raison de cette incertitude et de cette peur du chaos que provoquerait un changement trop brusque de modèle énergétique. On passerait ainsi d’un attracteur fossile à un attracteur renouvelable dans notre système énergétique complexe. Toutefois, cette transition amènera un lot de nouvelles technologies et une réorganisation du système humain qui est fondamental pour pallier aux risques des changements climatiques. L’important est donc de bien comprendre ces changements afin de prévoir et mitiger les effets négatifs pour avoir ainsi une transition en douceur.
Les solutions que nous apporte l’étude de ces systèmes
L’étude des systèmes adaptatifs complexes nous permet donc de mettre de l’avant des solutions pour faire cette transition énergétique et nous mener vers un monde plus durable, et enfin, dans une optique plus lointaine, de voir l’émergence d’une société humaine soutenable. La littérature met de l’avant certaines notions élémentaires. La première est l’importance de la diversité; elle permet de tester plusieurs innovations en même temps afin de voir ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas. L’augmentation des barrières à l’entrée, la difficulté du financement de nouveaux projets risqués, l’homogénéité culturelle et les inégalités sociales sont donc un frein à une transition durable. Ils empêchent l’innovation radicale, ce qui engendre une diminution de la diversité des solutions proposées. La seconde leçon repose sur la capacité d’anticipation et d’adaptation des sociétés. Elles doivent prévoir et anticiper les changements à venir pour être en mesure de mettre en place des stratégies d’adaptation qui seront garantes de sa survie. La pensée à court terme qui caractérise nos sociétés modernes est donc un frein au développement durable. Encore une fois, l’expérimentation est la seule manière, du moins pour le moment, de pouvoir bien évaluer si ces stratégies sont bel et bien les bonnes. Les décideurs doivent donc mettre en place des projets pilotes qui sont à l’avant-garde pour être en mesure d’évaluer les meilleures solutions. Il ne faut pas attendre que la société entière soit prête au changement, sinon les risques deviennent trop grands. Finalement, cette transition doit reposer sur des objectifs qui reposent sur des objectifs qualitatifs, mais qui sont mesurés de manière quantitative. Ainsi, il sera possible de se donner une vision et de mesurer la transition en ayant de multiples objectifs transitoires. En utilisant les concepts issus de la théorie des systèmes adaptatifs complexes, les différents gouvernements et organisations pourront ainsi commencer à avancer vers les nouveaux paradigmes engendrés par le développement durable.